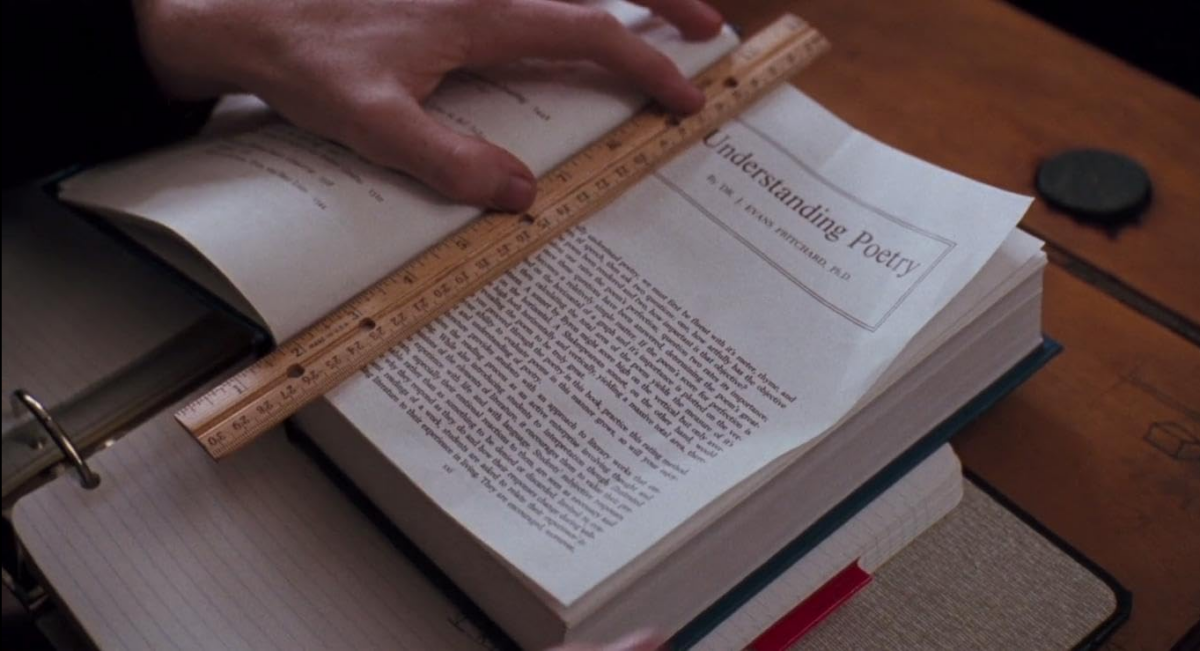Quel bel été 2025 !
Certes, il y eut quelques désagréments pour troubler la quiétude estivale : des chaleurs un peu vives dégénérant en incendies si difficiles à contrôler qu’ils ont dévasté des régions entières dans le sud, une guerre toujours en cours à une heure et demie d’avion de Paris vers l’est, et puis … Gaza.
Ce mot, si souvent prononcé, ressemble au bourdonnement d’un insecte qu’on n’arrive pas à chasser de son oreille. Il m’a amené à m’intéresser davantage à ce pays nommé Palestine et à celles et ceux qui, directement concernés ou non, ont écrit sur l’exil et le combat de ses habitants depuis 1948. Quelles belles rencontres j’ai faites cet été à ce sujet ! Aussi belles que ce dernier est aride, sordide, complexe, terrifiant.
Sur les conseils de ma fille aînée « Un détail mineur » d’Adania Shibli m’a servi de porte d’entrée, puis un recueil de poèmes de Mahmoud Darwich ; ensuite deux ouvrages d’Elias Sanbar – « Le bien des absents » et son Dictionnaire amoureux de la Palestine – m’ont rendu artificiellement familiers certains lieux et faits : la Nakba bien sûr ; Sanbar a quinze mois en 1948 quand sa mère l’emporte loin de sa ville natale, Haïfa ; il n’y reviendra qu’en 1995 ; la dolce vita du Liban d’avant la guerre : « Nous sommes la Suisse de l’Orient, répètent à l’envi les fêtards » ; la fierté arabe quand Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez ; la terrible désillusion de la guerre des six jours en 67 ; ces mots de son père (qui mourra le lendemain, 15 juin 67) : « Ne sois pas triste. Personne ne parviendra à se débarrasser de nous. La Palestine est une arête plantée dans la gorge du monde. Personne ne parviendra à l’avaler. Ne t’inquiète pas » ; les forêts d’Ajloun, théâtre de l’écrasement des feddayin par les troupes du roi Hussein de Jordanie en septembre 1970 …
Et puis cette incroyable rencontre avec Jean Genet que lui présente son ami Mahjoub, médecin égyptien communiste : « Tu connais l’ikhtyar (le vieux, surnom également utilisé pour désigner Arafat, qui n’avait pourtant qu’une quarantaine d’année à l’époque) assis là ? »
Car oui : j’ai également découvert le coup de foudre de Genet pour les Palestiniens jusqu’à cette forme d’épiphanie tragique qui le saisit en arpentant le massacre du camp de Chatila en 1982 et qu’il communique dans un texte-coup de poing extraordinaire, « Quatre heures à Chatila ».
Le foisonnant recueil de textes réunis par Jérôme Hankins autour de cette expérience a balayé l’idée très sommaire et caricaturale que j’avais de Genet et me l’a rendu aimable et étonnamment lumineux, tant son empathie – lui parle d’amour – pour ce peuple-paria apparaît sincère et profonde, et sa vision originale et féconde, par exemple cette image du tapis tiré sous les pieds des Palestiniens pour parler de la perte de leur terre, en trois secousses brutales (1948, 56 et 67) ; l’évocation de la beauté des feddayin que l’émancipation révolutionnaire soufflant dans les bases jordaniennes de 1970 transfigure et fait rayonner ; celle de la force et l’humour des femmes palestiniennes qui rendent la vie possible dans les camps de réfugiés et avec qui il ressent une immédiate complicité, tandis que leurs hommes, paysans désormais sans terre, se sentent humiliés et comme castrés, selon les mots de Leila Shahid qui ajoute : « Les hommes sont tous là avec les épaules courbées, le keffieh qui pend, ils ont l’air complètement figés, surtout les vieux. Les femmes sont très fortes, avec leurs fils à leurs côtés, les feddayin ; eux sont encore debout car ils ont un fusil, et d’une certaine manière, ce fusil leur rend une force que leur donnait leur présence sur leur terre. » ; autre exemple notable, la réflexion autour du regard de l’Occidental sur le paysage que constitue la misère du tiers monde pour expliquer ce qui, à ses yeux (ceux de Genet, j’y reviens), s’est joué en 1972 à Munich : « Le vrai luxe pour l’œil, c’est de pouvoir couver du regard un homme pauvre, ou des conditions de vie misérables, comme un objet décoratif. (…) Que personne ne touche au spectacle que je suis en train de contempler : je sais qu’il est fait de souffrances et de haillons, cependant il satisfait non seulement mes exigences esthétiques mais aussi mon besoin de prouver ma supériorité, en me montrant capable d’apprécier la condition du pauvre comme étant là pour me donner du plaisir. (…) L’apparition, sur les écrans de télévision et à la « une » des journaux, de la silhouette dissimulée sous une cagoule percée de deux trous et surmontée d’une sorte de « chignon » était à la fois effrayante et désagréable. Elle est la preuve, me semble-t-il, que Septembre noir refusait d’être ce paysage, ce tiers monde d’opérette, cette couleur locale où la mort et la misère, considérées de loin par les « spectateurs » européens, sont agréables à regarder. (…) En transférant la lutte en Europe, Septembre noir l’a ramenée sur son véritable terrain … »
Je n’étais pas encore né en 1972, mais je vois de quelle photo il parle. En revanche je me souviens dix ans plus tard de ce mélange de confusion, de gravité et d’horreur qui accompagnaient les quelques images de mauvaise qualité en provenance de Beyrouth à la télévision de l’époque ; je me souviens surtout de ces deux noms, Sabra et Chatila : les syllabes qui les composent semblent porter en germes la violence et la désolation.
À propos d’images, j’ai aussi vu « Ici et ailleurs », le film que Jean-Luc Godard a fini par sortir en 1976 à partir des rushes qu’il avait pris en 70 au sein de la guérilla palestinienne. Il se détourne logiquement de son projet initial au profit d’une réflexion sur la société du spectacle très en avance sur les temps à venir – qui sont les nôtres.
Qu’elle semble loin en effet aujourd’hui, la révolution socialiste et laïque des feddayin, à l’heure du Hamas ! Mais la juste revendication de ce « peuple de trop » (l’expression est d’Elias Sanbar) demeure, et les plus démunis de ses survivants sont en train de crever sous les yeux du monde faussement compatissant.
Je terminerai en reprenant cette interrogation du même Sanbar : « Nous avions l’habitude de dire : « les Palestiniens sont les juifs des Israéliens ». Et s’ils étaient en réalité leurs Peaux-Rouges ? »
Le 7 octobre 2023, certains d’entre eux sont sortis de leur réserve, pour le pire.
Long live Balestine !
(il paraît, selon l’auteur du dictionnaire amoureux de ce pays rendu à la fois imaginaire et concret par la force, qu’un moyen assez sûr d’identifier une personne d’origine palestinienne est son incapacité à prononcer le p qu’elle transforme en b quand elle s’exprime dans une langue autre que l’arabe)